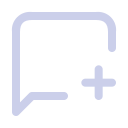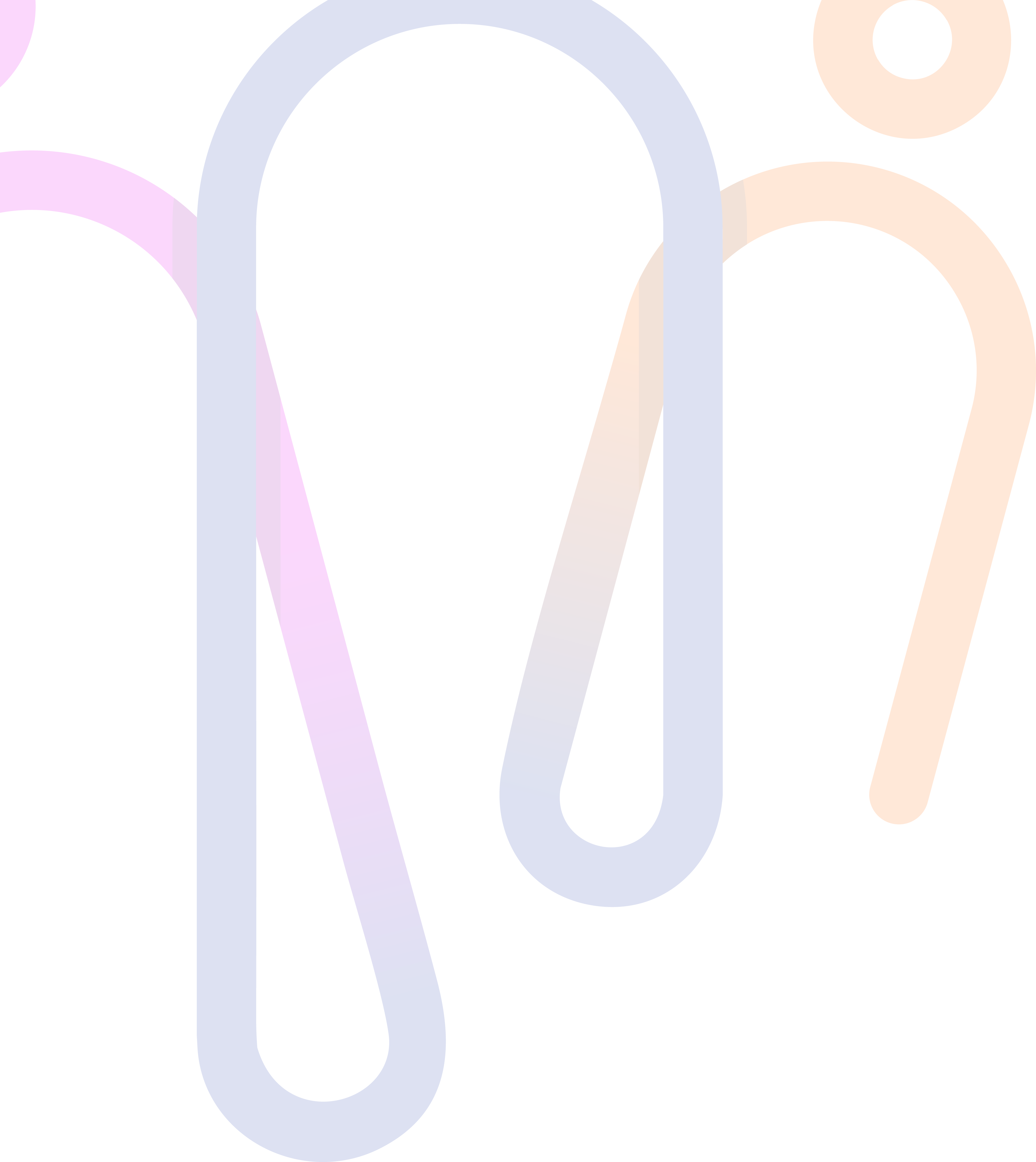
Fiche action 2 – Santé au travail des femmes # Approche sexuée en évaluation et en prévention des risques professionnels
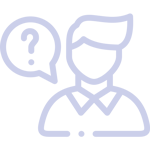
Actions réalisées dans le cadre du précédent PRST (action déjà inscrite au PRST 3) :
Ces travaux réalisés comportent essentiellement un volet d’apport de connaissances et de données épidémiologiques et conceptuelles en matière de santé au travail sexuée (« sensibilisation et formation »). Il reste à traiter un volet plus expérimental de mise en application de ces réflexions et de ces données dans une démarche inédite d’évaluation et de prévention sexuées des risques professionnels en milieu de travail réel.
Le contexte sanitaire 2020 a eu pour conséquence de suspendre les travaux envisagés par le groupe, qui nécessitaient la mobilisation d’entreprises et services de santé au travail, fortement impactés par la crise.
Ces travaux restent donc d’actualité, à savoir :
Cette action, par la nature de son objet, est très transversale.

Poursuivre la sensibilisation/formation
Notamment des préventeurs et des formateurs ainsi que des acteurs de la santé au travail au sein des établissements, afin de rendre visibles les enjeux existants en matière de santé au travail des femmes, et plus largement de santé au travail sexuée.
Agir pour une prise en compte de ces enjeux dans les actions d’évaluation et de prévention des risques professionnels mises en oeuvre par les acteurs au sein des entreprises/établissements et les préventeurs institutionnels (SPST, Carsat, Aract, Inspection du travail, etc…).
Rendre accessible, via des outils, à l’ensemble des acteurs concernés, la mise en pratique de l’évaluation et de la prévention sexuées, des risques professionnels en milieu de travail réel, notamment par des approches expérimentales : « DUERP sexué » (en cours) et « FE sexuée » (à débuter). Former dans ce cadre des acteurs relais pour mieux intervenir sur ces sujets, sur la base de ces outils.
Intégrer cette approche d’analyse sexuée en santé au travail à l’ensemble des actions du PRST 4, notamment en sensibilisant et en formant les pilotes des différentes actions opérationnelles : DUER, formation, risque chimique, RPS, maintien dans l’emploi, QVCT etc.
Pilotes : copilotage par Madame Ahez LE MEUR – DRDFE et Docteur Thomas BONNET – MIT.
Partenaires (actuels et potentiels) : DRDFE, DREETS, Réseau Anact-Aract, OS, OP, Co-Réso (service social du travail interentreprises), SPST, Médecine des Gens de Mer, Carsat, MSA, organismes de formations/OPCO (d’employeurs, de représentants du personnel, de préventeurs…).
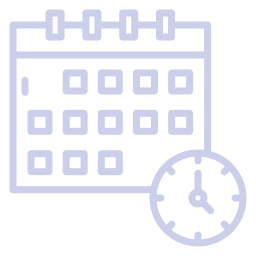
2022 – 2025.
Renforcer la prévention primaire et la traçabilité des expositions au risque chimique :
en accompagnant et formant les acteurs de la prévention du risque chimique (SPSTI, entreprises…) avec des outils dédiés au repérage et/ou à l’évaluation du risque chimique,
en mettant en place une action dans un secteur d’activité ciblé représentatif de la région,
en favorisant le développement et l’harmonisation de la biosurveillance en région Bretagne.
Engager des actions en faveur de la prévention des expositions au risque chimique des publics sensibles que sont les femmes enceintes et allaitantes et également les hommes et les femmes en âge de procréer.
Aider à l’évaluation du risque Radon en entreprise et proposer des actions pour diminuer l’exposition à ce gaz.